Le philosophe Guillaume Le Blanc publie chez Flammarion un livre passionnant sur la course : « Courir, méditations physiques ». Il part d’un postulat étonnant : «Les philosophes ne traitent jamais de la course à pied. Déjà les Grecs faisaient l’éloge de la tortue marcheuse, mais disqualifiaient le vaillant Achille pris dans la folie de ses enjambées… » Coureur lui-même, le philosophe revient sur les écrits de Descartes, de Rousseau, de Deleuze, de Walter Benjamin mais parle aussi d’Emile Zatopek ou de Marie-José Pérec. Les titres de ses chapitres sont autant de gourmandises pour qui aime courir. « Je cours, donc je suis », « Portrait du philosophe en coureur de fond », « Fuyards », « Le plaisir de souffrir », « Corps utopiques »… : Extraits de l’Interview en ligne sur le site de Rue89
Rue89 : Vous parlez des philosophes marcheurs. Il n’y a pas eu jusqu’à vous de philosophe coureur ? Le livre commence sur cette absence.
Guillaume Le Blanc : Oui, effectivement, j’ai cherché des philosophes coureurs, en vain. Il y a des philosophes nageurs. Chez Bachelard, on lit de très beaux passages sur ce sujet. Dans « L’eau et les rêves », il parle du fait de nager comme une activité d’opposition contre le monde. Il y a aussi les philosophes marcheurs. Platon, Kant, Rousseau, Aristote. Et puis, il y a même des philosophes gymnastes. Chez Platon, par exemple, pour être philosophe, il faut commencer par faire de la gymnastique. Mais le coureur, lui, est discrédité.
Comment expliquer cela ?
Pendant longtemps, le philosophe s’est méfié de son état de corps. Il a cherché à l’apprivoiser. La marche, c’était une possibilité d’être dans son corps, sans trop l’être non plus. Dans la course, au contraire, le corps est prépondérant. Il peut ou il ne peut pas.
Vous parlez du coureur comme d’un personnage philosophique. Pourquoi ? Ce texte, je l’ai un peu voulu comme un hommage caché à Deleuze chez qui il y a cette idée que la philosophie invente des personnages conceptuels. Ce que je trouve fascinant dans la course, c’est que ces personnages conceptuels sont réels. Ils existent et ils inventent une fiction : celle de la course à pied. On court dans un espace qui n’est pas destiné à la course, initialement. La ville est faite pour les voitures. Pour les piétons éventuellement. C’est cela aussi qui m’intéresse dans les courses organisées, les marathons ou les semi-marathons. C’est qu’à un moment donné les voitures ne passent plus. La ville se voit ré-ordonnée par cette hallucination collective qu’est la course. Une épreuve que chacun vient disputer, non pas pour la gagner, mais pour ressentir dans son corps ce que les autres à côté de soi ressentent. On est à la fois seul et avec d’autres. C’est ce que recherchent les coureurs pendant les courses, cette expérience de la meute
La course à pied est pourtant une activité controversée. On la présente souvent comme signe d’un monde qui va trop vite… ? Aujourd’hui, on a une norme de vitesse, de performance qui exige des sujets qu’ils soient vifs. Un bon travailleur, c’est quelqu’un qui répond vite à ses mails, qui se déplace rapidement. A tel point qu’on a l’impression que le coureur serait un symptôme de nos sociétés. Courir, ce serait la preuve qu’on est dans la normalité puisqu’on a rejoint la vitesse du monde. Il est certain qu’il y a une pression sociale à la course. On voit les grandes entreprises envoyer leurs cadres performants dans les marathons.
Mais pour autant je crois que ce serait une erreur de considérer que le coureur n’est qu’un symptôme de son époque. Ce serait manquer la dimension d’expérience de la course. Pour moi, la course est un symptôme et une expérience. Le coureur est pris dans le symptôme mais il ne cesse de le déborder en faisant une expérience. Et ces expériences, même si elles sont petites, ne sont pas sans intérêt, au contraire.
Moi, je crois beaucoup que les petites choses ont une grandeur. C’est une manière de ré enchanter le monde de l’ordinaire dans lequel nous sommes plongés.
Le coureur se situe dans la vitesse, dans les flux mais il essaye d’en faire quelque chose, quitte à ralentir le rythme de la vie aussi. Quand on court à douze kilomètres/heure, on est déjà dans une épreuve de lenteur paradoxale, par rapport aux voitures qui vous doublent. C’est donc pourquoi il serait absurde de penser la figure du coureur comme le décalque de ce monde hyper mobile.
Vous évoquez aussi l’incertitude de la course. On ne sait jamais en la commençant si on va pouvoir la finir et dans quel état on va la finir. Pourquoi êtes vous intéressé par cette dimension ?
C’est une leçon de contingence radicale. Je m’embarque dans quelque chose dont j’ignore l’issue. Je peux me la représenter mais ce qui se passe dans la course est toujours plus intéressant que ce que j’imaginais au départ. Ce peut être un détail, une parole échangée avec un coureur, le surgissement d’une fanfare dans un virage. Il y a toujours de l’imprévisible qui surgit et qui ramène à cette dimension de la contingence.
Ce que j’ai voulu explorer au fond, c’est la figure du coureur qui se hasarde à courir. Tout le contraire du programmateur de son corps que certains essayent de vouloir penser aujourd’hui, comme si le coureur était un ingénieur de son corps, maître de tous ces mouvements. Cette dimension d’automate, certes présente dans la course, ne va jamais très loin. La contingence de la vie reprend ses droits.
C’est vrai qu’il y a ces gens qui font leurs tours de pistes aussi.
Mais, ça, pour moi, ce n’est pas du tout contradictoire. Moi, dans ma pratique, j’ai deux, trois circuits, que je répète de façon obsessionnelle mais ce n’est pas en contradiction avec la possibilité d’explorer d’autres espaces, que ce soit dans son chez soi, prendre une rue plutôt qu’une autre, par exemple. Ou que ce soit en voyage parce qu’on prend une paire de baskets avec soi.
De l’addiction à la course, vous dites que c’est une manière positive de prendre conscience de son corps.
Il y a un état de manque quand on cesse de courir pendant un certain nombre de jours. Pour des raisons hormonales, l’addiction est très présente dans la course. Mais je crois que cette expérience est primordiale. Pendant longtemps, il y a eu un tabou autour de l’addiction.
On l’a pensée à travers ce qui détruit un sujet et non à travers ce qui l’aide à se construire. Les problématiques de la drogue, des stupéfiants ont absorbé la question générale de l’addiction. Je pense pourtant que l’addiction est un vrai problème métaphysique, au sens fort du terme.
Peut-on exister uniquement en soi-même et par soi-même ou est-ce qu’il ne faut pas se brancher sur des énergies extérieures ou sur des rythmes pour se sentir exister ? Oui, il y a une addiction qui se construit. Mais l’addiction peut aider à vivre.
Vivre, c’est sentir toutes les dépendances qui permettent cette vie. Et la question éthique, ce serait au fond la suivante : quelles sont les bonnes dépendances pour moi ? Quelles sont les dépendances qui augmentent ma puissance d’être et celles qui la diminuent ? C’est ce que Spinoza avait déjà formulé. Quelles sont les dépendances qui me rendent heureux ? Quelles sont celles qui me rendent triste ?
Qu’est-ce qui vous attire dans la course ?
Il y a quelque chose d’un peu masochiste dans la course. On cherche un type de bien-être, lié à une expérience de douleur. Il y a aussi cette dimension du passé-composé dans la course. « J’ai couru. »
Parce qu’après, il y a une forme de sérénité que je vois comme une forme de médecine.
Mais après quoi courez-vous ?
Alors ça c’est la grande question (rires). Il me semble qu’on court toujours après une certaine idée de la course. Elle se jouerait dans la course mais elle n’arrive sûrement jamais.
Je cours après quelque chose que je n’arrive jamais à rejoindre. C’est ça qui donne envie d’y retourner. C’est une énigme. C’est important de reconnaître que c’est une énigme profonde. Parce qu’on ne peut pas dire qu’on court après un type de plaisir. Il y a du plaisir mais c’est un plaisir très étrange. Il y a de la douleur aussi.
Moi je crois que courir, c’est se créer une petite figure pour soi que l’on emporte dans l’espace extérieur. Peut-être qu’on court pour éprouver cette transition continue entre le dedans et l’extérieur. Si je savais vraiment après quoi je cours, peut-être que j’arrêterais de courir.
Vous parlez de la course comme d’un appel au néant. Est-ce à dire que la course confronte à la mort ?
Je crois qu’à un certain moment quand on court, on est au bord de quelque chose comme le néant. Je ne dirais même pas que c’est la mort, mais c’est une expérience très troublante du rien.
Dans le marathon, en tout cas, il y a un moment où l’énergie qu’on a en soi n’existe plus. Quand on a commence à courir, on est optimiste. On pense qu’on pourra disposer de son corps, qu’on pourra faire appel à sa volonté. Et puis cette provision disparaît progressivement.
Tous les marathoniens racontent que vers le trentième kilomètre, cette énergie disparaît. Il n y’a plus rien. C’est le moment où l’on voit des gens qui s’arrêtent au bord de la route, qui pleurent, qui vomissent, qui sont dans des états seconds.
Et c’est très étonnant de se rendre compte que sa vie repose sur un stock énergétique qui n’est pas disponible à l’infini. Il y a là une finitude radicale. Alors, oui, on peut dire que courir, c’est sentir que l’on est mortel. Notre énergie n’est pas disponible à l’infini.
Est-ce pour cela que vous dites que la course est un vœu de pauvreté ?
Pour courir, il faut un peu faire vœu de pauvreté. Comprendre qu’on ne fait que passer. Quand on court, on comprend ce que ça veut dire qu’être de passage. Au sens propre du terme



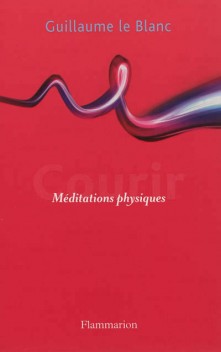
Dans un genre similaire, je conseille également la lecture de:
« Autoportrait de l’auteur en coureur de fond » d’Haruki Murakami
Avec le temps qu’il fait, il n’y pas mieux qu’une bonne lecture au chaud.